
Le maréchal
Alphonse
Juin
(1888-1967)
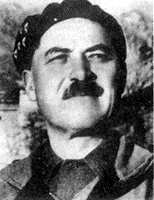 D'origine modeste.
Alphonse Juin, futur maréchal de
France, est né le 16 décembre 1888 à Bône, en Algérie, d'une mère corse
et
d'un père vendéen, gendarme de son état.
D'origine modeste.
Alphonse Juin, futur maréchal de
France, est né le 16 décembre 1888 à Bône, en Algérie, d'une mère corse
et
d'un père vendéen, gendarme de son état.
Boursier, il effectue ses études secondaires à
Constantine, puis
à Alger. En 1909, il entre à l'école militaire de Saint-Cyr et fait
partie de
1a promotion " Fez ~ où il a pour condisciple Charles de Gaulle. Il en
sort major et reçoit ses galons de sous-lieutenant le 1er octobre 1912.
Affecté au ler tirailleurs algériens, il fait ses
premières
armes au Maroc
Pendant la Grande Guerre, il s'illustre d'entrée et reçoit
la
croix de la Légion d'honneur en 1914, après la bataille de la Marne. Le
15
mars 1915, en Champagne, le lieutenant Juin est grièvement blessé au
bras
droit. L'amputation est évitée mais des séquelles ineffaçables
l'obligeront
définitivement à saluer du bras gauche.
Après la Première Guerre mondiale, Juin entre à l'école de Guerre dont
il
s'affirme comme un élève si brillant qu'il sera maintenu, contre son
gré,
comme professeur stagiaire.
Multipliant les démarches. il est affecté en Tunisie en
1921.
En 1923 sur l'intervention personnelle de Lyautey,
il se
retrouve au Maroc. Une solide amitié s'instaure bientôt entre
l'illustre maréchal
et le jeune capitaine. Juin va dès lors concevoir toutes les opérations
du
Moyen-Atlas au Tafilalet. Pénétré de la doctrine propre à Lyautey, il
se révèle
aussi bon stratège qu'organisateur avisé et fin diplomate. Cependant,
malgré
des états de service exceptionnels, son avancement se trouve
incroyablement
bloqué.
En
juin 1926, il est enfin nommé commandant. Lyautey est alors rappelé à
Paris,
Juin l'accompagne et reste attaché pendant deux ans à son état-major,
par fidélité.
En
1928, il épouse Marie-Cécile Bonnefoy dont le père est agriculteur dans
le
Constantinois.
Affecté
à Rabat, en 1929. comme chef de cabinet militaire du résident général
Saint,
il est amené à collaborer avec le général Noguès et se lie d'amitié
avec
le Glaoui, pacha de Marrakech. La pacification du Maroc est en voie
d'achèvement
quand il reçoit ses galons de lieutenant-colonel, en 1932.
En
1933, celui qu'on surnomme déjà Juin l'Africain est rappelé à Paris.
Adepte
de la guerre de mouvement et ennemi de l'attaque frontale, ses
arguments font
impression. Promu colonel en juin 1935, il est attaché à l'état-major
du
Conseil supérieur de la Guerre
Le
26 décembre 1938, le voici élevé au grade de général de brigade. Il a
tout
juste cinquante ans et se retrouve enfin à un niveau d'avancement plus
conforme
à ses mérites.
En
septembre 1939, alors que la Deuxième Guerre mondiale vient d'éclater,
il est
volontaire pour un commandement sur le front et se voit confier la 15e
division
motorisée. A la tête de cette valeureuse unité, il tient tête a
l'ennemi
dans le saillant de Valenciennes, couvrant ainsi la retraite anglaise
de
Dunkerque. Progressivement débordé sur les ailes, il est enfermé dans
les
faubourgs de Lille et fait prisonnier le 30 mai 1940, puis interné dans
la
forteresse de Konigstein.
Rapatrié
sur la demande du maréchal Pétain, il est promu général de corps
d'armée et
nommé commandant en chef pour l'Afrique du Nord, le 20 novembre 1941,
après le
rappel du général Weygand.
Lors
du débarquement allié en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, Juin
pousse
Darlan à proclamer le cessez-le-feu et favorise le ralliement à Giraud.
Il
passe des accords avec le commandement américain, ordonne la
mobilisation et déclenche
les hostilités sur le front tunisien, le 19 novembre.
Nommé général d'armée en décembre 1942, il commande de mai
1943 a Juillet 1944 le corps expéditionnaire français qui va se couvrir
de
gloire en Italie.
Vainqueur
sur le Garigliano, il offre aux Américains une voie triomphale et leur
ouvre
les portes de Rome, le 4 juin 1944.
Rappelé
à Alger comme chef d'état-major de la Défense nationale, il transmet
son
commandement au général de Lattre de Tassigny, le 23 juillet 1944.11
assumera
ensuite la haute fonction de résident général au Maroc, de
De
1952 à 1956, il exerce la charge de commandant interallié des forces
atlantiques terrestres du secteur Centre-Europe.
L'année
1952 marque pour Alphonse Juin l'apogée de sa carrière. Promu à un
commandement éminent, il est, par-dessus tout, élevé le 8 mai à la
dignité
de maréchal de France et, comme le veut la tradition, il est élu la
même année
à l'Académie française.
Après
avoir triomphé de tous les obstacles, donné tant de gloire à la France
et
atteint à l'honneur suprême, Juin verra les dernière années de sa vie
assombries par la guerre d'Algérie. Fidèle à ses origines, il exprime
loyalement son attachement à sa terre natale et, en 1962, il fait
publiquement
état de ses divergences quant à la politique algérienne du président de
Gaulle. Ce dernier le prive alors de toutes ses prérogatives.
Le
maréchal Juin s'éteint au Val-de-Grâce le 27janvier 1967. La France lui
fait
des funérailles nationales et il est inhumé aux Invalides.
![]() In L'Algérianiste n°66 de
juin 1994 p11
In L'Algérianiste n°66 de
juin 1994 p11
JUIN Adolphe (Bône, Algérie 1888 - Paris 1967). Maréchal de France (1952). Membre de l’Académie française (1953). De mère corse (Preziosa Salini), parlait corse selon un témoignage
Complément tire de ARMÉES D' AUJOURD'HUI numéros 272 juillet août 2002
|
|
|
Statue du Maréchal Juin
AIX EN PROVENCE photos http://martin.michel47.free.fr/

|
Militaire |
||||||||||||||||||||||||
|
Biographie Né à Bône (Algérie), Alphonse JUIN
(1888-1967)
Né à Bône (Algérie), le 16 décembre 1888.
Œuvres de Alphonse JUIN
|
Maréchal Alphonse Juin sur le site de BERNARD VENIS
http://perso.wanadoo.fr/bernard.venis/Alger/portraits/pages_liees/06_marechal_juin_pn35.htm
|
LES JOURS HEUREUX (L’ENFANCE DU MARÉCHAL JUIN)
Il est bientôt midi. Un jeune garçon de treize ans est allongé, nu, sur les pierres brûlées de soleil. Le visage tourné vers la surface de l’eau, si proche qu’il pourrait la toucher de ses cils et de ses lèvres, il observe avec une attention aiguë, à plusieurs mètres de profondeur, les splendeurs de la vie sous-marine révélées par la lumière qui tombe du zénith.
Au fond de cette crique abritée, de cette calanque aux eaux de cristal vert, lisses comme un miroir, ses regards plongent dans l’onde transparente, parmi les ombres et les lumières. Un amoncellement de blocs énormes descend et se perd dans un gouffre glauque, à donner le frisson. Leurs chevelures d’algues couleur de nuit sont animées de perpétuelles pulsations, comme vit et respire une forêt au rythme de souffles invisibles. Merveilleux lieu de méditation pour qui sait regarder et comprendre. Cet enfant sait déjà. Il regarde et médite.
A cette heure, le fond est abondamment peuplé d’êtres vivants. Voici toute une colonie de très précieux rougets de roche, au dos bossu, aux yeux ronds à fleur de tête, immobiles, le nez tourné vers la côte nourricière d’où tombe la provende. Leurs nageoires rose pâle sont étalées comme des éventails pour maintenir leur équilibre. Voici des perches de mer, noir et argent, portant sur leurs flancs, par une troublante anticipation culinaire, les diagonales sombres du gril qui les fera cuire, arrosées d’une persillade de beurre fondu. Nerveuses, elles ne cessent d’aller et venir, agitées et inquiètes. Que craignent-elles ? En ce lieu, elles ne courent aucunement le risque de cette mort sordide. Pas le moindre pêcheur dans cet éden oublié par le Créateur lorsque, pour châtier Adam, il mit en liquidation le paradis terrestre.
Mais voici que surgit d’une zone d’ombre, brillant soudain en pleine clarté, un essaim de girelles. Beaucoup plus calmes que les perches, minces comme des crayons tricolores, avec leurs bandes longitudinales bleu, blanc, rouge, elles sont si nombreuses qu’elles pavoisent d’un seul coup, pour un quatorze juillet aquatique, le rocher qu’elles survolent.
A deux mètres plus bas, une étoile de mer, découpée dans une écorce d’orange, se déplace précautionneusement, à pas lents dirait-on, s’aidant l’une après l’autre de ses cinq branches armées de ventouses. Mystérieusement averties de son approche par quelque radar secret, les coquilles Saint-Jacques ferment l’une après l’autre le clapet de leur porte cochère. Elles n’aiment pas cette promeneuse à l’allure taciturne, de mauvaise réputation. L’astérie a très gros appétit.
Mais que se passe-t-il ?
Dans un rejaillissement d’étincelles liquides, des centaines de crevettes en pâte de verre translucide, si invisibles que seuls les dénoncent les points noirs de leurs yeux, fuient en tous sens. Elles se ruent en panique hors du réseau frémissant des algues. Quel danger les menace ? Un mérou peut-être, ce lion des cavernes ? Non, c’est pire, ce n’est pas le lion, c’est le tigre, la langouste ! En voici une qui apparaît. Reine de la forêt sous-marine, elle en sort avec majesté, en écartant les branches, sûre de sa force, elle avance avec la lenteur d’un char blindé, patte après patte, les yeux fixes, ses deux antennes de poste à transistors repliées sur le dos. Carnassier exclusivement nocturne, pour qu’elle s’aventure ainsi à cette heure insolite, en plein jour, il faut qu’elle soit tenaillée par la faim. Malheur aux oeuf s de crevettes et aux enfants crevettons ! Elle va en faire carnage !
Le petit garçon contemple et réfléchit. Ces distractions en apparence futiles ne sont pas perdues pour lui. Il enregistre en profondeur. Le monde est un champ de bataille universel, sur terre, sous les eaux, dans les airs, partout ! Les uns dévorent, les autres sont dévorés, la loi est inexorable. Race privilégiée, la gent humaine appartient à l’espèce dévorante. Privilégiée, ou, qui sait, condamnée à la plus infamante honte, celle de se repaître de la chair des autres, de se nourrir de la vie de milliers d’êtres issus de la mer, du sol, même du ciel ? Mais à y réfléchir plus avant, s’agit-il bien d’une condamnation ? Doué d’une intelligence supérieure, donc étant le plus fort, l’homme ne se croit-il pas tout permis ? A l’origine, sa condition première était-elle vraiment de tuer pour assurer sa propre subsistance ? Ce qui au début a pu n’être qu’accident ou curiosité gourmande ne serait-il pas devenu à la longue accoutumance, puis besoin et finalement nécessité ? L’homme n’aurait-il pu se contenter de fruits, de légumes, de végétaux, de farines, de pain ? Mais, au fait, les végétaux, les arbres, vivent et meurent. Ils sont même sujet à la maladie. C’est donc qu’ils sont capables de connaître la souffrance ? L’homme leur dénie toute faculté sensorielle, est-il sûr d’avoir raison ? N’est-il pas aveuglé par son orgueil de soi-disant roi de la Création ?
Réflexions très
au-dessus d’un enfant de cet âge. Un jour,
il a interrogé son professeur :
— Les arbres souffrent-ils quand on les coupe ? Et le géranium que j’ai laissé mourir de soif dans son pot a-t-il souffert ? Le professeur surpris a ouvert de grands yeux et répondu, embarrassé : — On ne sait pas, c’est peu probable, mais peut-être... Surpris et embarrassé, mais aussi effrayé, on touche ici au domaine de la philosophie pure et cet enfant n’a pas treize ans ! Aussi a-t-il ajouté très vite : — Va donc jouer aux billes !
Réponse dilatoire. Comment jouer aux billes quand on est fils unique, absolument seul durant trois mois de grandes vacances dans ce véritable désert ? Non qu’il le regrette, il ne tient pas à jouer aux billes. Il préfère sa solitude ! Non par raison, mais par tempérament. Seul, il a tout loisir de regarder, d’observer, de réfléchir. C’est passionnant de lire dans le grand livre de la Nature ! Bien plus passionnant que de se mêler à la turbulence des cris et des jeux des camarades de votre âge. Et puis, on a le temps de lire aussi bien d’autres livres. Les livres, quelle porte ouverte sur le monde ! Il les dévore. Surtout ceux qui parlent de la mer, de cette mer qu’il voit chaque jour, qu’il ne quitte pas des yeux, même une heure, et qu’il aime. Elle est sa vie, il est en elle comme elle est en lui. La mer est son royaume. Est-il donc fils de roi, cet adolescent, pour posséder ainsi la liberté, l’immensité ? Regardez-le. Il vient de se lever de la dalle où il s’était couché pour scruter les profondeurs sous-marines. Le soleil l’éclaire de face, l’obligeant à plisser, les paupières. Il remet son caleçon de bains. Solidement bâti, svelte, bien planté sur ses jambes, il a le teint hâlé, avec un beau regard franc, aux yeux vifs couleur de noisette. Une mèche de cheveux châtains lui tombe sur le front, la bouche est ferme, les lèvres ni trop minces ni trop épaisses, indice d’équilibre et de bonté. En lui, tout respire la mesure, la maturité précoce, l’intelligence, l’humeur heureuse, la gentillesse, l’harmonie des muscles, la force, la souplesse. Mais qui est-il ce garçon de treize ans, d’où vient-il ? Et cette plage de conte de fées, en quel lieu de l’univers déroule-t-elle son sable et son soleil ? Fils de roi ou petit prince d’une planète inexplorée ? La vérité est plus simple. Il n’est qu’un petit garçon comme les autres. Il porte un nom quelconque, un nom inconnu qui ne dit rien à personne : Alphonse Juin.
Et son royaume est bien de ce monde, il s’étend à perte de vue sur le littoral de l’Afrique du Nord, sur cette côte méditerranéenne d’une beauté merveilleuse, avec ses criques inhabitées aux eaux limpides, ses falaises rouges, ses forêts de chênes-lièges vibrantes de cigales, dont les cascades vertes descendent depuis les hautes pentes et viennent baigner leur pied jusque dans la mer, avec leurs ombres épaisses et leurs ruisseaux d’eau vive cheminant secrètement sous les fourrés de lauriers-roses. Il en est ainsi pendant des centaines de lieues. De longs espaces de rivages développent leur féerie ignorée des foules. Pas une habitation d’homme entre les rares villes de la Calle, de Bône, de Bougie, d’Alger et, bien plus loin, d’Oran. Pas un gourbi, pas un feu dénonçant cette présence humaine qui plus souvent qu’elle ne l’améliore profane la beauté sauvage de la nature.
Nous sommes en l’an 1902. Depuis moins de trois quarts de siècle, les Français ont pris racine sur ce continent, après y avoir guerroyé durant plus de trente ans pour faire régner l’ordre dans cette Algérie où la domination turque, la dernière en date, n’avait réussi qu’à maintenir à l’état incurable la misère et l’incohérence sous toutes leurs formes. Ces Français du XIXe siècle ont pris la relève de conquérants ayant, les uns après les autres, prétendu apporter au Nord-Afrique, le plus souvent à leur profit, les bienfaits de leur civilisation. Les Carthaginois et les Romains s’y étaient essayés avant les Arabes et les Turcs. Des uns et des autres il n’est resté que des ruines.
Si, aux deux bouts de l’immense côte, à l’est et à l’ouest, la Tunisie et le Maroc étaient parvenus à se constituer en nations hiérarchisées, issues de leurs sols, il n’en avait pas été de même pour l’Algérie, toujours dénuée de structure d’ensemble, agglomérat élémentaire de tribus rivales, déchirées par des combats millénaires dont le pillage réciproque demeurait l’objectif immuable. Un seul lien commun entre elles, la pauvreté inhérente à l’ignorance et à la paresse.
De-ci, de-là, quelques chefs locaux plus évolués, résidus des races conquérantes, s’étaient bien levés, cherchant au nom d’Allah, mais plus souvent et plus profitablement en leur propre nom, à établir dans les vallées les plus fertiles quelque chose qui ressemblât à un état organisé, avec ses limites, ses cadres, ses coutumes et ses lois. Encore ne s’était-il agi que de territoires restreints, sans liaison d’ensemble entre eux. Mais d’Etat algérien, point ! L’Algérie n’était qu’une entité géographique inventée par les cartographes. En somme, une féodalité arriérée d’où n’était issu aucun roi, aucun empereur, aucun chef valable. Aussi parler de sentiment national algérien à la fin du XIXe siècle eût été un non-sens. Ce qu’il fallait de toute évidence à ce pays, pour pouvoir vivre et se développer, c’était s’en remettre à une grande nation moderne pour lui servir de support et se fondre peu à peu avec elle, comme fusionnent deux entreprises industrielles ou commerciales. Ce que d’autres puissances n’avaient pas su conduire à bien avant elle, la France du XIXe siècle allait-elle y parvenir ? Ses premiers pionniers, ses colons comme on les avait alors appelés, ceux de 1830 à 1890, avaient ouvert la voie au prix d’un labeur exténuant, souvent dangereux et mortel. Saurait-elle prolonger ce magnifique effort de quatorze ou quinze lustres pour commencer à défricher cette Algérie à demi-sauvage et aux trois-quarts inculte, l’organiser et la peupler de familles françaises ? Aurait-elle l’intelligence de le faire ? Saurait-elle en particulier, mettre en valeur cette côte algérienne, véritable joyau de la nature, au climat idéal, réplique, vingt fois plus belle qu’elle, de la Côte d’Azur française déjà deshonorée par l’afflux d’une foule devenue si dense que les toits commençaient à s’y toucher les uns les autres et que force serait bientôt d’y vivre au coude à coude et de s’y baigner hanche contre hanche, sans un espace libre ?
Ici, s’ouvrait un champ d’action immense, illimité, s’offrant tout neuf à l’initiative d’hommes jeunes et entreprenants. Il y aurait des lieues et des lieues de routes en corniche à dessiner, à creuser, des villes et des ports à construire, en ménageant avec soin des espaces libres où la nature serait respectée ; il y aurait à assimiler, à instruire une population autochtone maltraitée et brimée durant des siècles de servitude et devenue si misérable qu’elle ne souhaiterait dans son immense majorité qu’à se donner à qui saurait la soigner et l’aimer. Si la France le voulait, elle ne demanderait qu’à devenir française. Tout ceci, les Français le comprendraient-ils ? Sauraient-ils apprécier la chance prodigieuse qu’ils avaient devant eux ? Il y avait place ici pour des milliers de familles et des millions d’enfants. C’était un territoire exceptionnel de peuplement. L’élite de la France allait-elle s’y intéresser, en prendre la direction, ou l’abandonner à quelques gâcheurs, à des affairistes à qui échapperait la transcendance du grand problème à résoudre ? L’œuvre à entreprendre était exaltante. Tout était à faire, à créer, sur le plan spirituel comme sur le plan matériel, on taillerait en plein paradis terrestre. Mais un paradis terrestre, quand on le néglige, qu’on en remet la gérance à des chefs qui par incapacité ou mauvais vouloir trahissent leur mission, a vite fait de devenir un paradis perdu. Faute de chefs capables, faute de réformes et de soins, de générosité, de foi et d’amour, les Français de demain seraient-ils appelés à ne s’apercevoir qu’ils avaient eu dans les mains le plus fabuleux des trésors que lorsqu’ils l’auraient perdu ? L’exemple du Canada serait-il oublié ?
Pas la famille du petit Alphonse Juin, à coup sûr. Depuis deux générations (il représente la troisième) elle s’est consacrée à cette tâche de faire de l’Algérie un prolongement de la France. A des postes modestes, il est vrai. Mais chaque poste n’est-il pas d’importance quand il s’agit d’une grande entreprise ? Même les postes effacés ? Du côté de son père comme de sa mère, les deux familles ont servi la même cause, celle de l’ordre français à établir en Algérie. Son père, Victor Juin, après quinze années de services militaires dans l’infanterie lui permettant de prendre sa retraite proportionnelle avec le grade de sous-officier, a obtenu d’être versé dans la gendarmerie. En Algérie, bien entendu. Il a été affecté à la légion de Constantine. C’est là qu’il a connu celle qui deviendrait un jour son épouse et serait la mère du jeune Alphonse. Elle répondait au prénom romantique et charmant de Précieuse, Précieuse Salini. Elle était elle-même fille de gendarme, le brigadier Salini, d’ascendance corse, ayant, comme son futur gendre mais vingt ans avant lui, accompli quinze années de services dans l’infanterie et la Garde Républicaine, puis sollicité son affectation dans la gendarmerie d’Algérie. Demande agréée. Garnison Constantine. Les deux familles allaient se rencontrer, le destin se nouait.
Aujourd’hui, le jeune Alphonse Juin a treize ans. Ses grands-parents paternels sont morts, mais non son grand-père et sa grand-mère maternels. Et cela nous amène en ligne droite à cette calanque déserte, aux eaux transparentes, où vivent en abondance rougets de roche et perches de mer, où s’entre-dévorent astéries, coquilles Saint-Jacques, crevettes grises et langoustes.
Il est maintenant midi passé. Le jeune Alphonse le sait rien qu’à la hauteur du soleil. Là-bas, on doit sûrement l’attendre. On, c’est sa famille, ici représentée par son grand-père et sa grand-mère, une famille de style militaire, où le principe est sacré : l’heure c’est l’heure, même dans le civil. Aussi se hâte-t-il. Il traverse en courant l’ombre chaude et odoriférante de quelques arpents de lauriers-roses, escalade un repli de terrain et de là découvre un décor qu’il connaît depuis toujours, mais qui surprendrait le voyageur aventuré dans ces parages. Un promontoire dénudé, une falaise escarpée, s’avance dans la mer, portant à son extrémité une tour blanche irradiée de soleil, haute de trente mètres. Un phare ? Oui, un phare, avec à son sommet sa cage vitrée circulaire. La civilisation affirme ici sa présence, sa conquête. C’est le phare du Cap Rosa, construit depuis l’arrivée de la France. Il règne sur la solitude.
Le grand-père Salini, son temps achevé, avait en effet postulé pour être admis dans le Service des Phares et Balises. Ce nom romantique l’avait séduit, d’autant plus que de son enfance corse il gardait la nostalgie de la mer latine, avec son parfum d’iode et de varech, le murmure alterné du sac et du ressac drossant les galets, ou se brisant avec des détonations sourdes sur les rochers, symphonie majestueuse inoubliable, ponctuée du cri rouillé des oiseaux migrateurs. Tout cela, il le retrouverait comme gardien de phare. Cette nostalgie, il la transmettrait en ligne directe à son petit-fils, ce jeune Alphonse, qui précisément allait naître l’année même où, sa demande agréée, il se verrait affecter au Cap Rosa, son rêve.
Une femme âgée, aux traits fins — la mère de Précieuse —attend depuis quelques instants, tête nue, à l’ombre de la tour. Elle adresse des gestes pressants : — Tu es en retard, Alphonse ! — Mais non, grand-mère, c’est juste l’heure ! — Si, si, ne raisonne pas ! Cinq minutes ! Tu ne dois pas ! C’est la détente si reposante du déjeuner de midi. Le soleil entre à pleins bords par la porte large ouverte, les cigales chantent si fort sur la montagne qu’on les entend jusqu’ici. On mange dans la pénombre fraîche. Ils sont cinq autour de la table le gardien-chef Royer, tout près de sa retraite, et sa femme (leurs enfants ont l’âge d’hommes et sont partis ailleurs dans la vie), les grands-parents Salini (Salini n’est encore que simple garde) et le petit Alphonse.
Que de leçons de choses alors rien qu’à écouter la conversation des anciens ! Que de souvenirs colorés qui peuplent l’horizon! Le vieux Royer a fait la campagne de Kroumirie, il a entendu siffler les balles. Il est grand chasseur aussi. Il a même tué un lion, un des derniers sans doute d’Algérie laissés par Jules Gérard, il l’a tué ici, tout près de la côte, (il montre l’endroit) un énorme, un mâle avec une crinière comme ça, une seule balle au défaut de l’épaule ! Et les panthères et les sangliers, il y en avait plein la forêt sur la montagne. Il y en a toujours. Ne t’aventure pas trop loin, Alphonse ! Et là-haut, à la lisière, ou même en bas, en bord de mer, les perdreaux, des gros à collier noir et blanc, de quoi en remplir des sacs ! Et les cailles et les grives, qu’est-ce qu’il y en avait dans le temps ! On pouvait les tuer par centaines rien qu’à coups de bâton à l’arrivée des traversées, à l’époque des passages!
Le père Royer disait vrai, mais tout cela serait fini dans peu d’années. Les armes de chasse apparaissaient partout, se multipliaient. Les Français destructeurs, avec ces fusils Lefaucheux redoutables se chargeant par la culasse à l’aide de cartouches toutes faites, allaient dilapider ce trésor, anéantir ces réserves naturelles où le gibier abondait. Quelle tristesse ! Puis, ils évoquaient leurs souvenirs de soldats, leurs officiers, les camarades qu’ils avaient connus. Ils parlaient de la Corse, de la Vendée, de la Lorraine, de l’Alsace, ces provinces qui avaient donné un si grand nombre d’immigrants, dont beaucoup avaient été les premiers à défricher la Mitidja, alors pestilentielle. La plupart étaient morts à la peine. Le cimetière de Boufarik en était plein. Seulement, à la place des marécages, des buissons d’épineux, qu’est-ce qu’il y avait maintenant comme belles orangeraies, comme champs d’artichauts, comme vignes ! Parlant de la France, ils ne disaient pas la France, mais la Métropole. Car la France, c’était ici. Ils étaient ici en France, autant qu’étaient en France les Bretons nés en Bretagne, les Provençaux nés en Provence, les Dauphinois nés en Dauphiné, et tous les autres. L’Algérie maintenant c’était la France, ça ne se discutait pas, ça ne se discuterait jamais.
— Ceux qui naissent ici, comme toi, Alphonse, ils ne seraient pas Français alors ? Laisse-moi rire ! Et puis la Métropole, c’était si près, aussi près que la Corse de Précieuse, comme qui dirait sur les deux rives d’un même lac. Tout pareil ! — Quand tu iras en Métropole, Alphonse... Mais quand irait-il en Métropole, Alphonse ?... Quand la connaîtrait-il ? C’était tout près, bien sûr, mais le voyage quand même coûtait cher. Il y avait des années que les Royer n’y étaient retournés, de même les Salini et de même les Juin, tous issus de familles de soldats, c’est-à-dire de familles plus riches d’honneur que de billets de banque. Or, le bateau, cela se payait non avec un passé de dévouement, mais avec des francs et des sous, beaucoup de ces sous et de ces francs dont l’Etat se montrait si parcimonieux à leur égard.
— Si un jour j’étais riche, disait la mère Royer... — Si je gagnais le gros lot, disait la mère de Précieuse... — Tu seras peut-être riche un jour, toi Alphonse, disait le grand-père Salini. Paraît que tu travailles si bien à l’école, tu comprends tout... — Non, je serai soldat comme vous autres, je serai marin, officier de marine. — Alors c’est tout comme, tu ne seras pas riche, toi non plus. C’est pas mieux payé. — Oui, mais je verrai la mer tous les jours. Je ne veux pas la quitter. — Ça c’est vrai. Tu verras la mer tous les jours. Et voir la mer, c’est une richesse. Tout le monde ne peut pas se l’offrir. Tu as raison mon garçon ! Car c’est décidé, le petit Alphonse veut être marin. Il est possédé, envoûté par la mer. Depuis plus de dix ans il vient tous les étés passer ses vacances, toutes ses vacances du premier jour au dernier, au Cap Rosa, trois grands mois d’affilée, juillet, août, septembre. Ses parents restent confinés dans la caserne de gendarmerie de Constantine, ils ne peuvent lui payer d’autres vacances et le confient à ses grands-parents. Il n’est pas fils de roi, mais ses vacances sont royales, plus royales que n’en a jamais connu aucun roi de France enfant, même pas Louis XIV, et il n’en veut pas d’autres ! Trois mois de liberté incroyable en pleine nature. Sur cette côte déserte, il découvre le monde. Tant de grandeur, tant de silence le marqueront à jamais. Cette année 1902 est pour lui d’une importance exceptionnelle, il est à un tournant de sa vie. Jusqu’alors il n’a été qu’à l’école communale de la rue Petit, à Constantine. Ses instituteurs MM. Stotzel et Delessert ont noté la vivacité de son esprit, sa facilité, son assiduité au travail, sa rare intelligence. Il comprend tout, il retient tout. M. Delessert a insisté auprès du recteur de l’Université pour que lui soit attribuée une bourse lui permettant de suivre les cours de l’enseignement secondaire au lycée d’Aumale, à Constantine, afin de passer son baccalauréat. — Il ira loin, ce petit ! C’est la formule habituelle dont on se sert pour parler d’un bon élève. Rien n’est plus banal. M. Delessert en a usé presque sans y penser. Il n’a pas mesuré le poids qu’elle aurait dans l’avenir. D’ailleurs; l’avenir est un problème comportant un si grand nombre d’inconnues ! Son collègue, M. Stotzol a renchéri : Alphonse Juin est un sujet comme on en rencontre rarement! La bourse a été accordée. Ainsi va-t-il, à la rentrée d’octobre, quitter cette école primaire qu’il aimait et dont il était aimé. Cela l’impressionne un peu, mais il se rassure à la pensée qu’il ne sera pas trop dépaysé au Lycée d’Aumale. Il y retrouvera deux de ses camarades, Jacques Papi et Fernand Ardouin (1), avec lesquels il est en termes de grande amitié. Plus tard,
l’école communale de la rue Petit tirera fierté de montrer aux
visiteurs leurs trois noms gravés, parmi bien d’autres, à l’aide d’un
canif dans le bois des pupitres. M.
Delessert aura bien pu dire de chacun d’eux Il ira loin,
ce petit ! Il n’a pas moins poussé le
manque de clairvoyance jusqu’à avoir infligé aux trois coupables, sur
leur bout de leurs doigts, quelques coups réprobateurs de la redoutable
baguette d’osier dénommée bigottine.
Encore cinq ans, encore six fois l’enchantement des vacances au Cap Rosa. Mais le jeune Alphonse est devenu un adolescent. Le grand-père Salini lui a maintenant confié un fusil et permis de s’écarter assez loin. Aussi, en profite-t-il pour s’enfoncer dans la forêt, à la recherche des empreintes des chacals, des sangliers-phacochères et même des panthères. Celles-ci sont encore relativement nombreuses, elles survivront soixante-dix ans au dernier lion d’Algérie, mais disparaîtront comme lui, victime de l’indifférence, du manque d’imagination des Gouverneurs Généraux du début de ce siècle, dont aucun ne se sera soucié de la protection de la faune par la création d’un parc national du Nord-Afrique. Le grand-père Salini en a tué une l’année dernière. Un jour dans un sentier mal percé, dont les branches serrées le forçaient à se courber pour pouvoir avancer, le jeune Alphonse s’était trouvé nez à nez avec une panthère, une bête magnifique, au pelage ocellé de taches noires. Elle aussi chassait le sanglier. Interdite, elle s’était arrêtée, tous crocs découverts, les oreilles aplaties sur la tête, menaçante, prête à bondir. Que faire ? Alphonse n’avait pas de balle dans son fusil, mais de simples cartouches de plomb n0 7, pour perdreaux. Attaquer, c’est-à-dire tirer ? Folie, le rapport des forces était nettement en sa défaveur ! Avec beaucoup de sang-froid, il s’était immobilisé à cinq pas de la panthère, se contentant de la tenir en joue. Il serait toujours temps de jouer le tout pour le tout et de tirer à bout portant si le fauve lui bondissait dessus. L’idée de fuir ne lui était pas venue, sûr qu’il était de se voir immédiatement poursuivi, de recevoir la panthère sur les épaules et d’avoir la nuque broyée d’un coup de dents. Plusieurs histoires de chasse de son grand-père ou du garde-chef Royer l’avaient instruit à ce sujet. Seule, l’immobilité pouvait le sauver. De longues secondes avaient passé, le chasseur et le fauve, changés en statues, se fixant du regard. Puis, la panthère s’était décidée. Tout en se battant furieusement les flancs du bout de la queue, elle avait poussé un rugissement sourd, que le jeune Alphonse n’oublierait de sa vie, avait fait un à-gauche et était rentrée sans se presser dans le fourré, souveraine de son royaume (2).
Le soir, encore assez ému de l’aventure, il en avait narré les péripéties au grand-père Salini. Celui-ci en avait fait la critique en vieux soldat : — Tu as eu raison de ne pas attaquer, mais tort de t’être trouvé par ta faute dans cette mauvaise situation. Une troupe est foutue si elle monte à l’assaut armée seulement de pistolets à bouchon. « Si elle n’est armée que de pistolets à bouchon, c’est qu’elle est commandée par un chef imprévoyant, incapable. Il n’avait qu’à passer au magasin pour se faire donner de bons fusils et des munitions, avant de se mettre en route en pays ennemi. Pas vrai ? « C’est cependant ce que tu as fait. Tu es parti sans être passé au magasin. Avoir deux cartouches de 7 dans son fusil à deux coups, c’est complètement idiot ! Où te croyais-tu ? En Sologne ? Aie, si tu veux, une cartouche à perdreaux dans ton coup droit, mais toujours, tu entends toujours, dans un pays comme ici, une balle dans ton coup gauche. Tu l’as échappé belle ! « Si un jour tu deviens officier, ne conduis jamais tes hommes à la bagarre avec un armement insuffisant, inférieur à celui de l’adversaire, ne les engage jamais dans de mauvaises conditions. Rappelle-toi ça, mon garçon ! Le Maréchal Juin se le rappellera.
Mais il n’y a pas que la chasse à laquelle il se livre avec passion en ces dernières années de vacances au Cap Rosa. Il profite intensément de ces suprêmes moments de liberté. A seize ans, il est fort, solide, il a toutes les permissions, même celle d’accompagner les corvées de ravitaillement au petit port de la Calle, distant de 32 kilomètres. Celles-ci s’effectuent à l’aide d’une barque de pêche affrétée par le service des Ponts et Chaussées et manœuvrée par deux Calabrais payés par l’administration. Le trajet par bon vent demande deux ou trois heures, mais il peut aussi bien durer une journée entière si par malheur le vent faiblit ou souffle en proue. Alors, à la grande satisfaction du jeune Alphonse, il faut tirer des bordées, faire preuve de réelles qualités de marin. Les deux Calabrais s’y entendent parfaitement. On peut aussi accomplir le trajet par voie de terre, à cheval ou à mulet, mais par une mauvaise piste, sinuant d’abord entre deux lacs et traversant ensuite, douze kilomètres plus loin, une sorte de vaste clairière irriguée au moyen de seguias, en lisière de la basse forêt. Là, une fraction de la tribu des Brabtia, où le grand-père Salini compte de nombreux amis, s’adonne à la culture du maïs et des arachides, son unique ressource avec l’élevage de maigres troupeaux, sur lesquels, dans les temps anciens, le lion prélevait sa dîme — beaucoup plus lourde, disent les Brabtia, que l’impôt, cependant déjà abusif, du dey d’Alger pour le compte du sultan de Turquie.
L’été, par le soleil accablant, bêtes et gens rompus de fatigue et de soif parviennent avec soulagement à l’ombre tutélaire, si longuement désirée, de la tour du phare et de son bouquet de figuiers. Alphonse préférait la mer. Mais quelle vie magnifique ! Pas un nuage au ciel ! Quelquefois, si étrange que cela soit dans ce désert, on voit arriver un détachement de quelques militaires du génie sous les ordres d’un sous-officier. Ils viennent s’entraîner aux transmissions optiques avec les sémaphores du Cap de Garde à Bône et de la pointe de Tabarka en Tunisie. Alors, le soir les conversations se prolongent tard, sous les tentes-marabout, entre les soldats et le grand-père Salini et le garde-chef Royer. Parfois, aussi, mais rarement, survient une équipe de langoustiers de Bône. Ils restent alors deux ou trois semaines, l’endroit étant bon pour la pêche. Le soir venu, ils tirent leurs barques pontées sur la grève et confectionnent les nasses de roseaux où ils conservent leurs prises, échangeant parfois avec la grand-mère Salini contre un litre de vin une langouste très belle mais dépréciée pour la vente parce qu’il lui manque une patte ou une antenne. La nuit est déjà noire, le ciel criblé d’étoiles, que le jeune Alphonse reste encore parmi les langoustiers, allongé parmi eux sur le sable, écoutant leur propos, n’en finissant plus de les interroger sur leur métier, de les faire parler sur le temps, sur le vent, sur la mer.
A quelque distance de là, sur la plage du Grand Canier, non loin du camp des langoustiers, se dresse un petit cimetière marin avec deux tombes d’infortunés pêcheurs italiens péris en mer. Les vagues ont jadis rejeté leurs corps sur la côte, on les a enterrés là sur place, avec deux pauvres croix de bois, toutes simples, les deux premières que verra le jeune Alphonse. Tout enfant, conduit par sa grand-mère, il venait déjà les fleurir, impressionné par la notion d’éternité et d’au-delà qui se dégageait de ces deux croix et qu’elle éveillait dans son âme. Aujourd’hui encore, alors qu’il est adolescent, la vue de cet humble cimetière marin l’incline à la rêverie, à la méditation. Il en mesure la grandeur. La contemplation de l’infini de la mer le captive de plus en plus. Même quand il arpente le haut de la forêt ou du maquis, il la cherche des yeux à travers les branches. Il n’en perd aucun des aspects, si changeants selon l’heure ou la couleur du ciel. Et les nuits où souffle la tempête — malgré tout assez fréquentes en Méditerranée — il reste longtemps éveillé, accoudé à son oreiller, écoutant avec une émotion grave et merveilleuse le grondement des vagues déchaînées se ruant à grands coups sourds contre les assises du phare. Là-haut, au sommet de la tour, passe et repasse la lueur alternée du faisceau lumineux, venant jusque dans sa chambre projeter les rayons et les ombres des raies de ses persiennes. Que béni soit le phare de son grand-père qui, peut-être, là-bas, dans l’horreur des ténèbres de la mer démontée, apporte son réconfort aux navigateurs en péril et calme leur angoisse ! Ah, être un jour marin ! Vivre comme Robinson Crusoé, le héros de ses rêves d’enfant, la prodigieuse aventure des terres et des océans ! Etre marin ?... Il va bientôt connaître la première grande déception de sa vie. Alphonse Juin ne sera pas marin.
l‘heure d’envisager sérieusement l’avenir a sonné. S’il ne devient
pas marin ce ne sera pas à lui que devra en être imputée la faute mais
à l’école de la rue Petit. Elle a bien
signalé au représentant de l’Académie ses rares qualités de sujet doué
et intelligent, mais elle l’a fait tardivement. Elle
a conservé trop longtemps sur ses bancs un élève lui faisant honneur,
elle ne s’est pas préoccupée assez tôt de ses intentions de carrière. Deux années précieuses ont été perdues. Pour d’autres cela n’eût été que de relative
importance; pour lui, candidat possible aux Grandes Ecoles, c’était lui
porter grandement préjudice. Entré à
treize ans en sixième au Lycée d’Aumale, un simple calcul suffisait à
démontrer, étant donné, à l’époque, les conditions d’admission à
l’Ecole Navale, qu’il n’aurait, au sortir des Mathématiques
Elémentaires, qu’une seule fois à se présenter. Ce
serait bien peu et le succès d’autant plus problématique que le Lycée
d’Aumale n’assurait aucun cours spécial de préparation au Borda.
Réaliste, le jeune Alphonse Juin, allait bientôt renoncer à cette illusoire préparation. Son ambition se bornerait à être admis à Polytechnique où la limite d’âge était plus longue. Or, Polytechnique disposait chaque année de quelques places réservées (à la vérité très peu nombreuses et souvent enlevées par les premiers de chaque promotion) aux élèves les mieux classés, leur permettant d’entrer ainsi « par la bande » dans la Marine Nationale. Il y aurait là pour le jeune Juin un moyen de parvenir à ses fins. Sur le conseil du proviseur du lycée de Constantine, son père obtint de le faire admettre, toujours à titre de boursier, comme interne au lycée d’Alger. Mais là-bas l’attendait une nouvelle déception : il n’y aurait pas dans les prochaines années d’hypotaupe au lycée d’Alger. Le professeur de mathématiques, par ailleurs remarquable, réservait ses efforts à la préparation des anciens, les meilleurs candidats n’étant généralement reçus que la troisième année. Les bizuths étaient de ce fait négligés. Or, le bizuth Alphonse Juin se trouverait déjà limité en deuxième année, un sort malencontreux l’ayant fait naître un 16 décembre. Précieuse l’avait mis au monde avec quelques jours d’avance, ceci le priverait de pouvoir se présenter à une session supplémentaire. Ainsi ces misérables quinze jours allaient-ils déterminer de manière décisive l’orientation de sa destinée. Il arrive que dans une vie d’homme de tels impondérables pèsent d’un poids inattendu. Que faire dans cette conjoncture ? Aller en Métropole, à Paris, suivre les cours de ces institutions réputées, telle la Rue des Postes, où les fils de famille étaient chauffés à blanc pour parvenir à tout prix à franchir les portes des grandes écoles militaires, Polytechnique, Navale, Saint-Cyr ? Alphonse Juin n’était pas un fils de famille... Ces maisons n’étaient pas des institutions d’Etat, mais privées. Son traitement de sous-officier de gendarmerie ne pouvait permettre à Victor Juin d’y envoyer son fils.
Victor Juin, sous son modeste uniforme, était un homme de grande clarté de vues et de jugement sûr. Lecteur passionné, il s’était formé lui-même, il avait beaucoup appris dans les livres sur lesquels il était constamment penché. Il était parvenu à une grande culture, à une véritable érudition, dont restaient surpris et admiratifs tous ceux qui l’approchaient. Or, ayant bien pesé le pour et le contre, estimé que la préparation à Polytechnique à Alger était hypothéquée de trop d’aléas, alors que celle de Saint-Cyr, excellente, obtenait chaque année de beaux succès, il avait fait comparaître son fils : — Ecoute, Alphonse, il ne faut pas se bercer d’illusions. Il s’agit de voir clair. Tu risques de ne pas être reçu à Polytechnique. Or, tu as déjà du retard. Si tu échoues, tu auras perdu deux années pour rien. Que deviendras-tu ? Ce sera fini pour toi... « Tu veux devenir officier ? Alors à ta place je préparerais Saint-Cyr. Là, je crois que tu as de belles chances de réussir. Réfléchis, mon garçon, et décide toi-même ! »
De nouveau réaliste, le jeune Alphonse après avoir renoncé à Navale, avait renoncé à Polytechnique, renoncé à jamais à être marin, renoncé à la mer. Il se présenterait à Saint-Cyr. Il avait ainsi pris un grand tournant de sa vie, un virage essentiel, définitif. En vérité, ces quinze jours d’avance de sa naissance avaient fixé son destin. Né deux semaines plus tard, il se fût présenté à Navale ou à Polytechnique. Reçu, il eût fait un excellent marin, mais jamais un maréchal de France. Ainsi, sa mère, la chère Précieuse, lui avait-elle à son insu rendu le plus beau des services.
GENERAL CHAMBE (1) Jacques Papi sera
reçu à Polytechnique et Fernand Ardouin à Saint-Cyr en même temps
qu’Alphonse Juin. (2) J'ai eu le
privilège d’entendre le Maréchal Juin évoquer devant moi ce souvenir.
( Article
paru dans la REVUE DES DEUX MONDES du 1er septembre
1968 )
|
LE MARÉCHAL JUIN, “DUC DU GARIGLIANO”
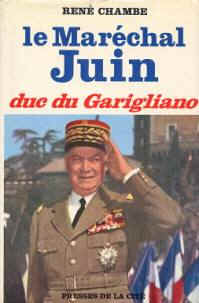
Combattant des deux guerres mondiales, la
carrière du général Chambe est beaucoup trop longue et trop compliquée
pour l’exposer en quelques lignes. Retenons-en
seulement l’essentiel en ce qui concerne ses rapports avec le futur
maréchal Juin.
Resté son ami après la guerre, il a continué
de le voir très souvent et de noter, au cours de leurs entretiens, ses
pensées, ses réflexions, ses réactions durant les vingt dernières
années, en particulier au moment du drame algérien, qui fut pour lui si
cruel.

|
Pardonnez mon retard à vous
remercier de votre courriel et de votre lien vers le site du général
Chambe.
Puisque votre site est sur
le Maréchal Juin (je l'ai rencontré, ainsi que son
épouse, deux fois chez mon grand-père le général Chambe), je vous
signale, outre Le Maréchal Juin - duc du Garigliano
(Presses de la Cité), le général Chambe a publié trois autres livres où
figure le Maréchal Juin : La Bataille du Garigliano (Ditis),
L'Épopée Française d'Italie (Flammarion) (préfacé
par A. Juin) et Le Bataillon du Belvédère
(Flammarion).
Vous trouverez, en attaché,
photos et préface susceptibles de vous intéresser.
Pour éviter d'éventuels
problèmes de réception, je vous adresse en attaché, sur un autre email,
la préface du Maréchal Juin.
Amicalement !
Pierre
JARROSSON generalchambe@free.fr
|
 Une Lourde porte de bronze, dissimulée derrière le grand autel de
l'église
Saint Louis des invalides, donne accès à un escalier de pierres qui
mène à la
crypte creusée sous le sanctuaire. C'est dans cette crypte que depuis
trois siècles
sont ensevelis les gouverneurs des invalides.
Une Lourde porte de bronze, dissimulée derrière le grand autel de
l'église
Saint Louis des invalides, donne accès à un escalier de pierres qui
mène à la
crypte creusée sous le sanctuaire. C'est dans cette crypte que depuis
trois siècles
sont ensevelis les gouverneurs des invalides.
ALPHONSE JUIN voulait être enseveli dans sa terre natale, sur le rocher de Sidi M'Cid, dans la lumière du soleil d'Afrique bercé par le grondement des eaux du Rhummel.
Dans le profond silence du caveau des gouverneurs, le Maréchal JUIN repose au milieu de ses pairs, qui, comme lui dans les travaux de la paix comme dans le fracas des batailles, n'ont eu qu'une pensée: servir leur pays.
photos provenant du magazine la charte
| 1967 |
27 janvier Mort du Maréchal Juin A 78 ans, Alphonse Juin, dernier maréchal de France, s'éteint à l'Hôpital du Val-de Grâce à Paris. Il s'était notamment distingué à la tête des forces françaises libres d'Afrique du Nord lors de la libération de l'Italie et du débarquement en Provence. Maréchal de France en 1952 et membre de l'Académie Française, ses obsèques donnent lieu à un grand moment de ferveur gaulliste et télévisée. |

SITES
http://www.cgb.fr/monnaies/modernes/m10/gb/monnaiesgbd410.html
http://perso.wanadoo.fr/bernard.venis/Alger/portraits/pages_liees/06_marechal_juin_pn35.htm
http://www.academie-francaise.fr/immortels/discours_reception/juin.html
les invalides mois de mai 2005
musée de l'artillerie Draguignan juin 2005
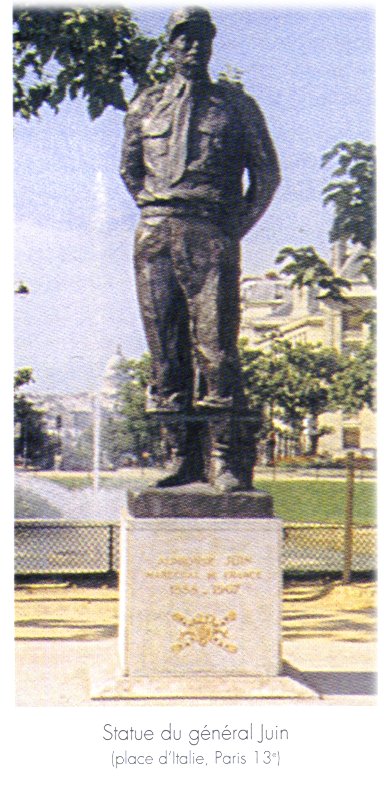
|
|||||
|
L'arrivée du général Juin
|
MARECHAL JUIN
DE L ACADEMIE FRANCAISE
LE MAGHREB EN FEU
1957
Ce site est dédié à la réunion du quarantième anniversaire d'entrée à Coëtquidan de la
PROMOTION MARÉCHAL JUIN
1966-1968



Les 23 et 24 septembre 2006
http://marechal-juin.effisk.net/
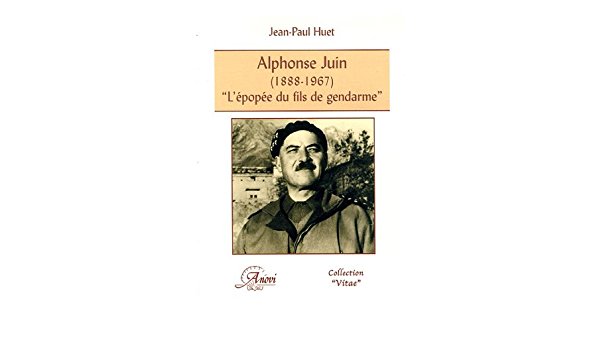
|
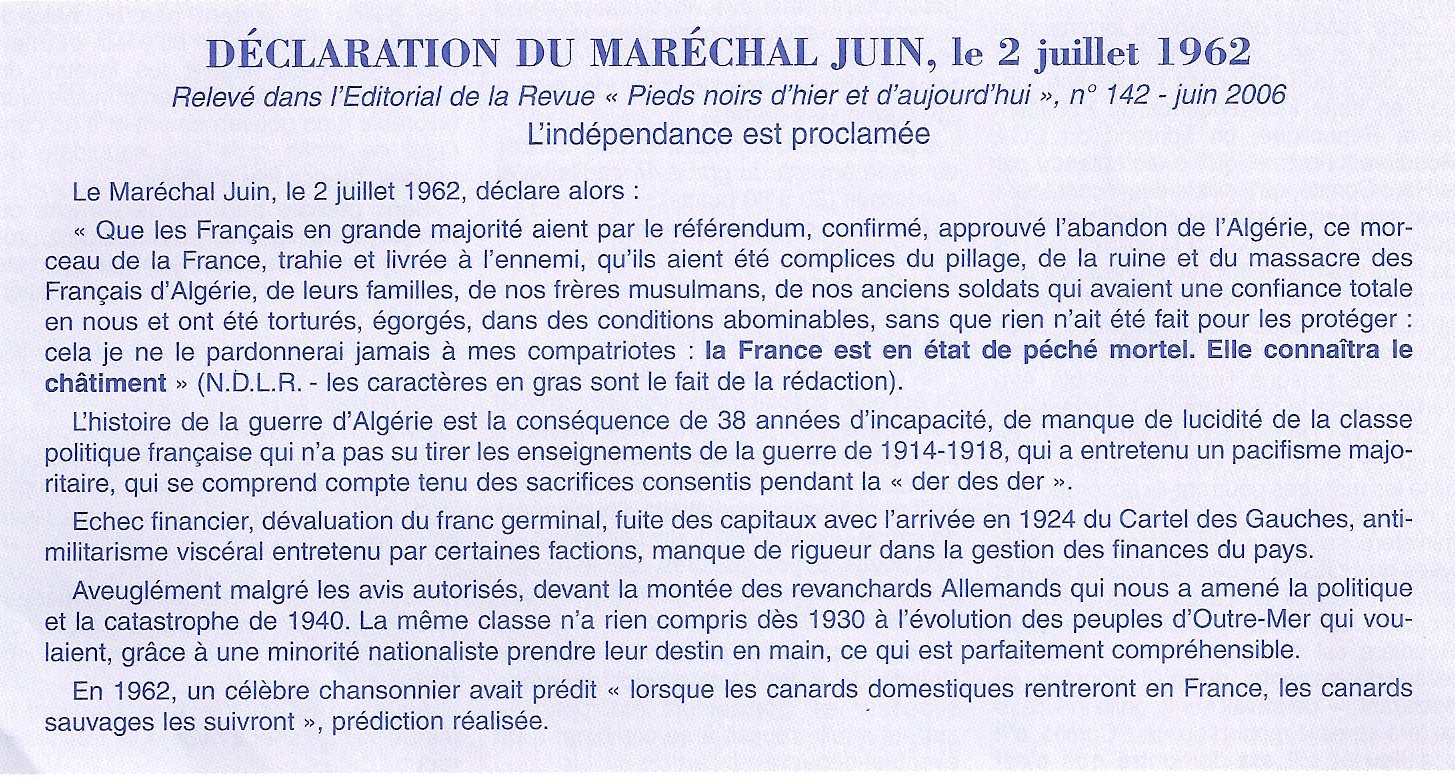 |

 |
|
ANECDOTE
(Echo
D’Alger 12/05/1958)
|
la seybouse de Jean pierre BARTOLINI http://www.seybouse.info/seybouse/infos_diverses/mise_a_jour/maj73.html N° 73
|
magazine terre magazine
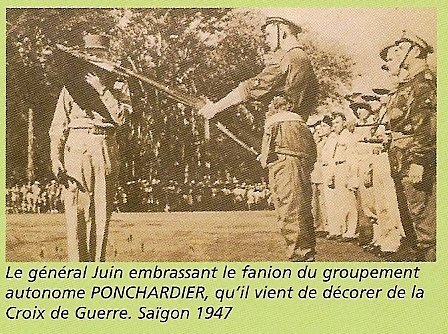
corse matin du 21-01-2010
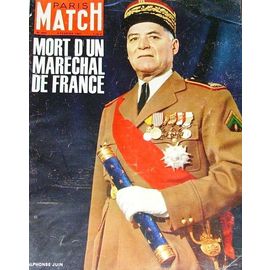
|
|
Début janvier 1961.
Le
maréchal JUIN ayant publiquement annoncé son désaccord avec la
politique algérienne des gaullistes, degaulle, son ancien camarade de
promotion (Juin sorti premier de Saint Cyr et degaulle 13è..) lui supprime son état major :
un officier d'ordonnance,
deux secrétaires,
deux voitures avec chauffeur,
soit les avantages attachés à la qualité de MARECHAL,
faute de pouvoir lui enlever cette distinction.
No Comment.
*